Au nom de tous les miens, Martin GRAY
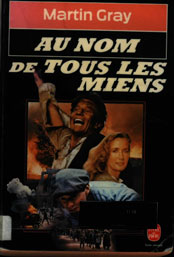
I Comprendre
1) L'histoire
Tiré d'une
paisible enfance à Varsovie, Martin est plongé en 1940 à 16 ans dans l'horreur
du Ghetto, où il devient contrebandier. Déporté à Treblinka avec toute sa
famille (sauf son père), il s'en échappera dans un wagon d'habits pris aux
victimes, les autres membres de sa famille ayant été assassinés. Fuyant pendant
des mois les camps de travail et d'extermination, il aide la résistance
polonaise, puis retourne au Ghetto pour participer à sa révolte (où il retrouve
son père qui se fait tuer), dont il est un des seuls survivants. Il s'engage
dans l'armée Rouge et prend part aux combats pour s'emparer de Berlin. La paix
revenue, il fait fortune aux Etats-Unis. Alors qu’il a fondé une famille dans
le sud de la France, celle-ci périt dans un incendie de forêt.
2) Le lieux
Treblinka,
situé à est de la Pologne est le deuxième camp le plus meurtrier après
Auschwitz Birkenau (750 000 victimes). Il s'agit d'un Camp de Mort "classique" (meurtre par chambres à gaz puis
ensevelissement des corps dans une fosse commune) et non d'un Camp de
Concentration (esclavage) comme Mauthausen ou Dachau .Il "reçoit" les
Juifs des ghettos des plupart des grandes villes polonaises.
II la
déportation
Après avoir décrit la survie dans le ghetto, Martin
raconte son expérience des camps. Nous avons choisi de ne rendre principalement
compte que de cette partie.
1) Le départ
pour les camps
L' Umschlagplatz, la
gare du ghetto de Varsovie, sert de point de départ pour le Camp de Mort de
Treblinka. Martin et sa famille y sont amenés à
la mi-septembre 1942. La stratégie très "efficace" des nazis
consiste à attraper une partie d'une famille afin de servir d'appât aux autres
membres. Les SS ne jouent en réalité qu'un petit rôle sur le terrain, étant
servis par les policiers juifs (travaillant au Conseil juif : Le
judenrat) et les mercenaires étrangers (ukrainiens). Les déportés
sont ensuite enfermés dans des wagons surpeuplés (prés de 150 par wagon) pour un
voyage de nombreuses heures dans une ambiance horrible (faim, soif, odeur
d'urine et d'excréments, manque d'air). A l'arrivée, beaucoup seront morts.
2) La
sélection
"Hommes à droite, femmes et enfants à gauche,
répétait un haut-parleur d'une voix tranquille."
La sélection
est effectuée par les SS ("les
maîtres") ou leur subordonnés Ukrainiens("leurs chiens"),au Camp de
Treblinka, dès l'arrivée du train.
A gauche sont
également dirigés malades, vieillards, blessés. La surveillance de la sélection
est stricte et nul ne peut y échapper, à gauche se trouvant le Lazaret-le camp
d'extermination-, à droite le camp de travail.
3) Comment
éviter la panique chez les déportés ?
Dans le ghetto
de Varsovie, les Nazis promettaient qu'à l'est
se trouverait une vie meilleure, ce qui permet de les faire monter dans
les wagons sans panique. Bien que tous perdent leurs illusions durant le
trajet, on fait croire à "ceux de gauche", destinés à la mort, qu'ils
seront simplement envoyés dans un camp similaire à celui de "ceux de
droite" Dès la séparation, on annonce à ceux de gauche qu'ils vont prendre
une douche, et on leur demande de se déshabiller. Pour les rassurer, leur
cacher leur mort proche et éviter toute panique, on leur dit de conserver soigneusement
objets de valeur et papiers et de prendre le savon qu'on leur offre.
4) Les
sentiments des déportés
A peine séparé
de sa famille, Martin s'informe de leur sort:
"-où vont ils?
-qui?
-ceux de gauche.
-au camps d'en bas.
-…
-le Lazaret
-…
-le gaz."
C' est tout ce
qui restait du monde de Martin qui s'écroule, mais au lieux de céder au
désespoir comme les autres, il gagne la force de rester en vie pour que le
monde sache ce que font les "animaux
à visage d' homme", "aux
noms de tous les siens".
III La vie
dans les camps
"Ceux de
droite", ceux destinés au camp de travail, n'auront guère droit à un
meilleur sort. Ils vont connaître des conditions de vie particulièrement
horribles.
1) L'horreur
quotidienne
Les
prisonniers, sous-nourris, épuisés au travail doivent
constamment faire face à l'horreur. Pendant des heures, chaque jour, on leur
fait un discours sur leur infériorité. Tous ceux qui sortent des rangs,
oublient de baisser la tête au passage d'un SS ou d'un Ukrainien, sont promis à
la mort, directement ou indirectement, lorsque, le lendemain, ils seront
emmenés au Lazaret. Les plus
désespérés, se suicident durant la nuit par pendaison -raison pour laquelle on
laisse aux détenus leur ceinture-ce qui hante Martin qui, cinq ou six fois par
nuit, entend les "retirez"
des suicidaires qui demandent à leurs compagnons de retirer les caisses sur
lesquels ils sont placés.
2) Le travail
Les
prisonniers sont répartis en équipes de travail surveillées, les kommandos. Il en existe diverses sortes,
mais leur travail ne sert en fait qu'au fonctionnement du Camp de Mort :
arrivée des déportés, tri de leurs habits, de leurs cheveux qui leurs ont été
coupés, entretien des allées... Mais les plus "mal lotis" sont les
Juifs de la Mort, chargés de récupérer les corps (auxquels les Juifs "dentistes" retirent les dents
en or) des chambres à gaz et de les jeter dans une fosse commune. Les enfants,
échappant parfois au gaz grâce à leur taille, sont étranglés par les kommandos lorsque les gardes ne regardent
pas afin de leur éviter d'être enterrés vivants. Martin fait partie notamment
les kommandos de tri des habits,
d'entretien des allées et de Juifs de la Mort.
3) La révolte
et l'évasion
La révolte
semble bien souvent impossible, plus en raison de la peur que des gardes. Même
dans les camps provisoires -ou les prisonniers "attendent" d'être
envoyés à Treblinka lorsque le camp est plein -la peur surmonte l'envie de
révolte pour sauver sa famille, et parfois simplement les autres, des
répressions. Treblinka se révoltera -en vain- mais Martin se sera déjà évadé:
affecté au "Camp d'en bas", le Lazaret,
en tant que Juif de la Mort, il s' accroche sous un camion de dents en or, qui
le reconduit au "Camp d'en haut" où il convainc un kapo -un surveillant juif souvent
collaborateur -de l'affecter au nettoyage des voies de chemins de fer, puis
saute dans un wagon d'habits, qui lui permet de s'enfuir dans la campagne
polonaise.

Arrestation des
derniers survivants après l’insurrection du ghetto de Varsovie (Mai 1943)
Cette photo est
devenue le symbole de la résistance des Juifs au génocide.
IV L'intérêt
du témoignage
Ce témoignage
non romancé et très précis, écrit à la mort de sa femme dans un incendie (dans
les années 1970), nous donne une idée très concrète de la déportation en
précisant son horreur et en donnant tous les sentiments du narrateur, qui a été
confronté à presque tous les aspects de l'antisémitisme et les raconte (et non
pas "seulement" le Ghetto ou un "seul" Camp), transmettant
sa tristesse, son envie de vivre et son besoin de vengeance. Mais malgré cette
dernière, le témoignage sait rester objectif, montrant, par exemple, un SS
amical, un racketteur de Juifs héroïque, ou des soldats russes (vainqueurs de
Berlin) se transforment en violeurs. En plus d'être
précis historiquement, Au nom de tous
les miens est un livre passionnant et plein de suspense, qui communique
sans peine au lecteur, par ses descriptions sentimentales comme par sa
narration crue, toutes les émotions de Martin Gray.